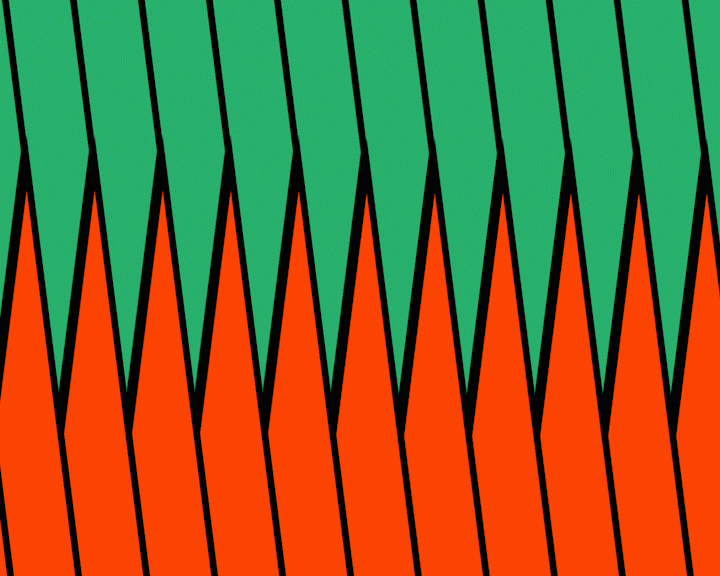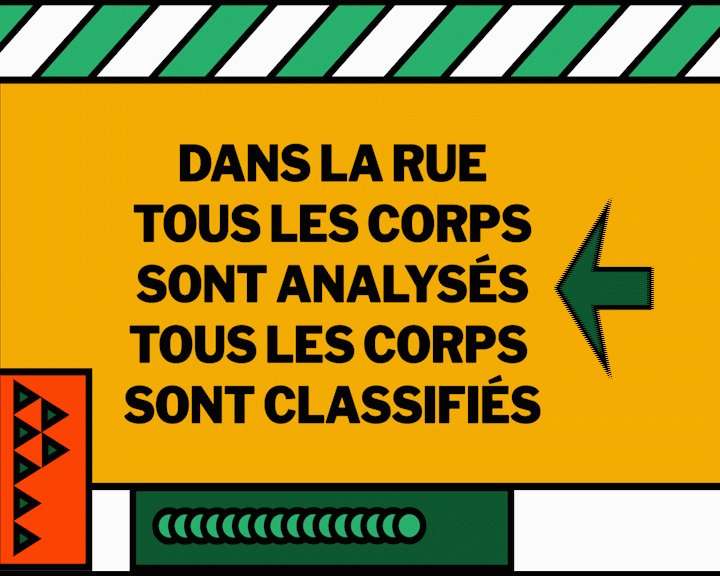PLAINTE COLLECTIVE CONTRE LA TECHNOPOLICE
Merci ! Vous êtes 15248 à avoir rejoint la plainte. Nous l’avons déposée à la CNIL le 24 septembre.
Télécharger les plaintes contre : L’espace public est surveillé par 1 million de caméras qui, de plus en plus, sont équipées de logiciels visant à détecter des comportements « indésirables ». La police utilise la reconnaissance faciale 1 600 fois par jour à partir des 8 millions de visages du fichier TAJ, et enregistre dans le fichier TES le visage de toute personne demandant un passeport ou une carte d’identité.
Contre ces pratiques illégales, La Quadrature du Net et ses 15 248 mandataires on porté plainte devant La CNIL samedi 24 septembre 2022.

Dans le détail
La surveillance totale de l’espace public résulte de la combinaison de trois systèmes de surveillance : la vidéosurveillance généralisée, le fichage de masse et l’emploi croissant de logiciels d’Intelligence Artificielle analysant nos corps et nos visages. Chacun de ces dispositifs justifie et renforce les autres, formant un super-système qu’il nous faut contester dans son ensemble.
Vidéosurveillance
En France, la police peut accéder à 1 million de caméras de surveillance. Pourtant, leur présence dans la rue ne diminue pas le nombre d’infractions (au mieux, elle les déplacent) et ne contribue à la résolution que de moins de 2% des enquêtes résolues. En droit, l’inutilité de cette surveillance de masse suffit à la rendre illégale.
Le déploiement des caméras de surveillance est particulièrement opaque. La dernière tentative de décompte, réalisée par la CNIL, remonte à 2012. Elle en trouvait plus de 800 000 dans l’espace public. La Cour des comptes dénombre quant à elle, en 2020, 80 000 caméras gérées par la police. Les autres étant installées par des entreprises filmant la rue ou des espaces publics intérieurs et mettant leurs images à disposition de la police. Le nombre de caméras accessibles par la police en 2022 ne peut qu’être évalué de manière approximative : il a évolué depuis 10 ans pour dépasser le million – et probablement bien au-delà.
Les effets des caméras sont eux aussi sous-documentés. Il a fallu attendre 2020 pour qu’une première étude réalisée par la Cour des comptes conclue qu’ « aucune corrélation globale n’a été relevée entre l’existence de dispositifs de vidéoprotection et le niveau de la délinquance commise sur la voie publique, ou encore les taux d’élucidation ». En 2021, une seconde étude plus détaillée, commandée par la gendarmerie, conclut elle aussi à une absence d’effet sur la commission d’infraction et à une utilité résiduelle pour l’élucidation des infractions commises (1,13 % des enquêtes élucidées ont bénéficié des images de caméras sur la voie publique). Ces conclusions recoupent celles déjà établies par des chercheurs indépendants ou par les autorités d’autres pays.
Difficile de comprendre pourquoi les caméras envahissent nos rues si leur efficacité est quasi nulle. Nous imaginons deux raisons : offrir une rente aux entreprises de sécurité françaises et, surtout, donner l’illusion que les élus locaux agissent pour leur ville, sans avoir à investir dans des politiques publiques qui seraient véritablement utiles mais plus difficiles à mettre en œuvre. L’omniprésence des caméras permet ainsi de diffuser l’idée (clairement fausse en l’espèce) selon laquelle la sécurité de la population reposerait sur l’action de la police plutôt que sur des politiques sociales, de soin et d’entraide.
Or, en droit, il est interdit d’utiliser des caméras de surveillance sans démontrer leur utilité. L’ensemble des caméras autorisées par l’État en France semblent donc être illégales. Elles sont pourtant nocives, imposant un sentiment de culpabilité et de menace à l’ensemble de la population, limitant l’exercice de nos libertés fondamentales d’aller et de venir, de réunion, d’expression et de tranquillité dans l’espace public.
Concrètement, nous allons demander à la CNIL de faire enlever toutes les caméras qui filment la voie publique et dont l’utilité pour protéger la population n’a pas été démontrée au préalable. A priori, cela pourrait conduire à retirer l’ensemble des caméras déployées en France. Nous avons conscience que cette demande peut sembler radicale, mais l’effet nocif des caméras sera de plus en plus important sur le long terme avec l’installation progressive de logiciels sur ces caméras (voir ci dessous), qu’il sera beaucoup plus difficile d’empêcher tant que les caméras seront là.
Fichage
L’État a mis en place cette dernière décennie deux méga-fichiers : depuis 2012, la police fiche 8 millions de visages dans le fichier de « traitement des antécédents judiciaires » (TAJ). Et depuis 2016, toute personne demandant une carte d’identité ou un passeport a son visage inscrit au fichier des « titres électroniques sécurisés » (TES).
En 2012, l’ancien fichier de la police nationale (STIC) est fusionné avec celui de la gendarmerie (JUDEX) dans un nouveau fichier, le TAJ. Comme pour les caméras, l’état actuel du TAJ est particulièrement opaque. Les dernières informations viennent d’un rapport parlementaire de 2018 : à l’époque, il « existe 18,9 millions de fiches de personnes mises en cause » par la police pour des crimes, des délits ou certaines contraventions (telles que des dégradations légères). Peu importe que ces personnes soient ou non condamnées par la justice, la police peut arbitrairement décider de leur ouvrir une fiche pour une durée de 20 ans (en théorie, le procureur devrait mettre à jour les fiches en cas de décision favorable à la personne mise en cause, ce qui semble n’être presque jamais le cas en pratique).
Le rapport de 2018 estime que « le TAJ comprend entre 7 et 8 millions de photos de face » – il n’est pas précisé d’où viennent ces images, aussi la police a-t-elle pu les récupérer elle-même, au commissariat ou sur le terrain, ou bien via des caméras de vidéosurveillance, ou encore sur Internet ou sur d’autres fichiers de police. Si, depuis 2018, plus d’une personne sur 10 a son visage dans le TAJ, les perspectives sont encore plus alarmantes avec le fichier des « titres électroniques sécurisés » (TES).
Le fichier TES est créé en 2005 pour centraliser les informations (nom, domicile…) de toute personne demandant un passeport français. Depuis 2008, le TES enregistre aussi « l’image numérisée du visage » de ces personnes. En 2016, le TES est étendu aux cartes nationales d’identité et comprend le visage des personnes qui demandent une telle carte. Ici encore, les informations officielles font défaut mais, avec un renouvellement des passeports et des cartes se cumulant à environ 10 millions par an, on imagine que l’ensemble de la population sera bientôt fichée dans le TES, si ce n’est pas déjà le cas (seules les personnes qui refusent encore d’avoir des documents d’identité, telle que la loi le permet en théorie, échappent de fait à ce fichage).
En 2016, le gouvernement avait justifié le fichage de l’ensemble de la population en mettant en avant des risques de fraude au moment du renouvellement des passeports et des cartes d’identité. Ce risque, qui était déjà extrêmement faible en 2016, a entièrement disparu depuis qu’une puce – qui contient le visage et les empreintes – est désormais présente sur les passeports et permet de remplir la même fonction de façon décentralisée. L’enregistrement du visage de l’ensemble de la population dans le fichier TES n’a plus aucune justification : il est donc illégal et doit être supprimé avant d’être dévoyé par la police pour d’autres usages abusifs.
Concrètement, nous allons demander à la CNIL de réduire considérablement le nombre de visages enregistrés dans le fichier TAJ puis de déclarer illégal l’ensemble du fichier TES.
Reconnaissance faciale
Depuis 2012, la police utilise des logiciels de reconnaissance faciale pour comparer les photos de visages contenues dans le TAJ aux images qu’elle capte par vidéosurveillance, sur Internet ou lors de contrôles d’identité. En 2021, elle réalisait 1 600 opérations de reconnaissance faciale par jour, en dehors de tout cadre légal.
Le décret de 2012 qui a créé le fichier TAJ prévoit que chaque fiche peut contenir « la photographie comportant les caractéristiques techniques permettant le recours à un dispositif de reconnaissance faciale ». À partir de cette seule et unique phrase, et sans qu’aucun autre texte juridique n’autorise ou ne réglemente cette pratique, la police s’est octroyée le pouvoir de déployer un logiciel de reconnaissance faciale pour identifier des personnes déjà fichées dans le TAJ.
Sur le terrain, les anecdotes ne tardent pas à s’accumuler. En 2013, des gendarmes niçois se réjouissent : « un homme ayant perdu la tête a été trouvé dans le jardin d’une propriété et il s’est révélé incapable de donner son nom. Les gendarmes l’ont pris en photo et nous l’ont envoyé. Et « bingo », sa fiche est sortie. Il a pu être identifié, puisqu’il était connu des fichiers ». En 2014, le Figaro rapporte à Lille un cas d’identification automatisée d’un adolescent, déjà fiché au TAJ, qui s’est vanté sur Snapchat et à visage découvert d’avoir volé un téléphone : « une fois la photo en notre possession, il n’a fallu que quelques minutes pour que 30 ou 40 visages apparaissent à l’écran, explique un commandant ». Plus récemment, les témoignages de reconnaissance faciale utilisée lors de contrôles d’identité se multiplient. Toutes ces opérations sont réalisées sans le moindre encadrement juridique spécifique. La police agit de son propre chef et selon des règles et méthodes qu’elle a définies seule.
Depuis 2012, au fur et à mesure que la technologie s’affinait, ces opérations n’ont cessé de croître. Un premier rapport parlementaire indiquait que la police réalisait 1 000 opérations de reconnaissance faciale par jour en 2019, puis 1 200 en 2020. Un second rapport montre que ce chiffre est passé à 1 680 en 2021. En parallèle, ce même rapport révèle que les services de renseignement se livrent eux aussi à des opérations de reconnaissance faciale, notamment pour « la recherche du visage d’une cible particulière dans un flux vidéo ». L’ampleur et les conditions de cette pratique restent encore parfaitement inconnues. Enfin, nous redoutons que la police et les services de renseignement puissent indirectement utiliser les visages de l’ensemble de la population contenus dans le fichier TES pour faire de la reconnaissance faciale ou que de prochaines évolutions juridiques puissent en autoriser l’exploitation directe.
À partir des ces informations parcellaires, nous pouvons estimer que la police utilise aujourd’hui la reconnaissance faciale dans trois cas :
- identifier une personne lors d’un contrôle d’identité ;
- identifier une personne qui apparaît sur une image obtenue au cours d’une enquête judiciaire (à partir d’une caméra de surveillance, de réseaux sociaux, de drones, etc.) ou bien par les services de renseignement (dont l’activité comprend la surveillance des contestations politiques) ;
- détecter la présence sur un flux vidéo d’une cible suivie par les services de renseignement (qu’il s’agisse de terroristes, d’agents d’États étrangers ou d’opposants politiques jugés dangereux).
Tandis que ces pratiques sont aujourd’hui illégales, de nombreux politiciens souhaitent les autoriser. Des parlementaires ont proposé des lois et des rapports pour permettre à titre « expérimental » des mesures de reconnaissance faciale qui, en vérité, sont déjà réalisées depuis 10 ans et de façon massive. Ces textes proposent aussi d’autoriser des pratiques nouvelles, telles que le filtrage de l’accès à certains lieux ou la détection de personnes recherchées par la police judiciaire.
La Commission européenne propose des évolutions similaires dans son Acte pour l’Intelligence Artificielle, qui ne s’encombre même plus des faux-semblants d’une phase expérimentale. Le gouvernement français se démène actuellement pour que ce texte offre à sa police tous les nouveaux pouvoirs attendus. Le délai qu’il s’est officiellement donné pour achever ces transformations est la tenue des Jeux Olympiques de 2024 à Paris, qui seront l’occasion pour les entreprises françaises de sécurité (Thales, Atos, Idemia, Sensivic, Evitech, XXII, Two-I…) de faire la démonstration de leurs technologies au monde entier afin de vendre encore davantage d’armes de surveillance.
Alors que l’ensemble des CNIL de l’Union Européenne ont appelé à une interdiction pure et simple de la reconnaissance faciale policière dans l’espace public, les décideurs ignorent ces signaux d’alarme. Ces technologies sont sur le point de s’imposer à l’ensemble de la population sans l’avis de celle-ci, avec pour effet de faire disparaître l’anonymat de l’espace public et d’aggraver de façon terrifiante les risques d’abus de la police contre les minorités et les personnes militantes. La présente plainte collective est une façon de reprendre notre place dans le débat, en rappelant que ces pratiques sont aujourd’hui interdites et doivent le rester.
Concrètement, nous souhaitons que la CNIL ordonne à la police et aux services de renseignement d’arrêter de mettre en œuvre les opérations de reconnaissance faciale actuellement réalisées. Nous pensons que l’arrêt de ces pratiques est la seule façon crédible de protéger nos libertés. Notre expérience passée devant la Justice nous a démontré que les quelques garanties théoriques prévues par la loi pour encadrer de telles pratiques ne permettent pas en pratique d’en limiter les abus (voir par exemple pour les services de renseignement ou l’usage de drones policiers). Notamment, il nous semblerait illusoire d’espérer que des juges ou que la CNIL puissent vérifier au cas par cas et au quotidien que la police n’abuse pas de technologies, telle la reconnaissance faciale, dont le caractère automatique et opaque rend leur fonctionnement massif, tentaculaire et impropre à tout contrôle indépendant efficace.
Détection automatisée de comportements
Sans débat public, de plus en plus de villes équipent leurs caméras de logiciels détectant et signalant automatiquement à la police les personnes que celle-ci juge indésirables ou suspectes, qu’il s’agisse de personnes qui font la manche, traînent, courent, taguent, se regroupent, etc.
La vidéosurveillance algorithmique (VSA) a transformé les caméras « classiques » dans les rues de nos villes. Cette technologie, vendue par ses promoteurs comme une « aide à la décision », est en réalité une couche algorithmique ajoutée aux caméras pour repérer et analyser les comportements ou mouvements prétendument « suspects » que la police veut traquer. Son déploiement se fait en toute opacité et sans aucun débat public, dans probablement plus d’une centaine de villes aujourd’hui, laissant le champ libre aux industriels pour promouvoir et perfectionner leur produit dont nous sommes les cobayes.
Car c’est un véritable marché de la sécurité urbaine qui est aujourd’hui le moteur de la surveillance de nos villes, mettant en concurrence différentes entreprises pour vendre leurs algorithmes à toujours plus de collectivités. Par exemple, Briefcam, une entreprise implantée dans une quarantaine de pays, fournit son logiciel permettant de condenser des heures de vidéos en quelques minutes à la plupart des communes françaises équipées de VSA. À coté, Two-i, start-up française, propose des services de « reconnaissance d’émotion ». Pendant la pandémie de covid-19, elle s’est vantée de sa solution d’analyse de flux vidéo visant à alerter, via les caméras de surveillance publiques, tout regroupement ou tout non-respect des distances entre deux personnes.
Si les entreprises tentent de minimiser les enjeux pour vendre leurs produits à tout prix, nous voulons montrer la réalité des effets de la VSA. Ces logiciels criminalisent les comportements les plus banals (rester trop longtemps au même endroit, courir…) et stigmatisent les personnes qui passent le plus de temps en extérieur – les personnes qui n’ont pas ou peu accès à des lieux privés pour sociabiliser ou pour vivre. Cette technologie n’a que pour but de « rationaliser » la ville et d’en exclure ceux et celles qui sont jugées comme indésirables, marginalisant encore davantage les personnes les plus vulnérables. Comme les caméras, la VSA permet aux décideurs de contourner les débats politiques complexes en entretenant deux fausses croyances : les violences se produiraient principalement dans la rue et la technologie serait capable de les limiter.
Surtout, ces algorithmes donnent à la police des pouvoirs et capacités opérationnelles décuplés, qu’il lui serait impossible d’obtenir avec son nombre actuel d’agents. Nous assistons à un changement d’échelle de la surveillance de masse : l’ensemble de nos déplacements sont en permanence passés sous l’œil de ces logiciels pour être analysés, classifiés, réprimés. Dès lors, les conséquences des abus de la police s’en trouveront elles-aussi décuplées. Ce traitement automatisé de nos corps est selon nous illégal, c’est pourquoi nous l’avons déjà attaqué à Marseille et à Moirans en Isère. Aujourd’hui, nous voulons y mettre fin en l’attaquant à la source via notre plainte contre les caméras qui en sont le support matériel.
Plainte collective
Notre plainte collective peut être rejointe par toute personne vivant en France. C’est gratuit et sans risque juridique pour vous. Remplissez dès maintenant le formulaire et tentez de convaincre le plus grand nombre de personnes de faire de même !
Depuis 2018, le droit des données personnelles nous permet de nous unir pour attaquer collectivement des pratiques illégales devant la CNIL. En mai 2018, nous avons réuni 12 000 personnes dans une plainte contre les GAFAM. Ces procédures sont encore en cours mais ont déjà donné quelques beaux résultats, telle que l’amende record de 746 millions d’euros contre Amazon.
Aujourd’hui, nous proposons une plainte pour attaquer la surveillance totale de nos villes. Depuis trois ans, au sein de l’initiative Technopolice, nous documentons les nouvelles technologies policières qui transforment la ville. En dépit de quelques victoires locales, un constat alarmant s’impose : la Technopolice se répand de façon bien trop opaque, massive et rapide pour être suffisamment connue et débattue par la population qui, de fait, se trouve privée de ses capacités d’auto-détermination.
Au niveau local, les mairies accompagnent souvent ces changements mais, surtout, c’est le ministère de l’intérieur qui, d’en haut, permet à l’ensemble de la Technopolice de faire système. Les caméras, le fichage et les logiciels sont autorisés, financés et mis en œuvre par le gouvernement, dans une politique à la fois libérale et autoritaire. Libérale, pour maintenir son industrie sécuritaire au niveau de celle de ses concurrents chinois et états-uniens. Autoritaire, pour abroger l’anonymat dans l’espace public et maintenir la population sous la menace constante d’une police sur-équipée. Pour défaire la Technopolice en tant que système, notre plainte vise l’État français et son ministère de l’intérieur.
Rejoindre notre plainte est pour vous gratuit et sans risque juridique. La Quadrature du Net prend à sa charge les frais nécessaires (on vous invite éventuellement à y contribuer en nous faisant un don si vous le pouvez). Nous ne demandons à l’État aucune réparation économique, mais uniquement de cesser ses pratiques illégales et d’effacer les données illégalement collectées.
La plainte sera déposée devant la CNIL, qui a été créée en 1978 pour lutter contre la surveillance d’État mais qui, depuis, a largement déserté cette mission. Ce n’est que par une plainte massive que nous pouvons espérer la ramener à son rôle de contre-pouvoir. Mais le but de notre action n’est pas que juridique : il s’agit aussi d’imposer un rapport de force politique. Unissons-nous massivement pour reprendre notre place dans le débat public et faire savoir que la Technopolice est illégale et doit le rester.
Nous vous invitons à remplir dès maintenant le formulaire pour mandater La Quadrature du Net, puis à tenter de convaincre le plus grand nombre de personnes de faire de même. Merci !